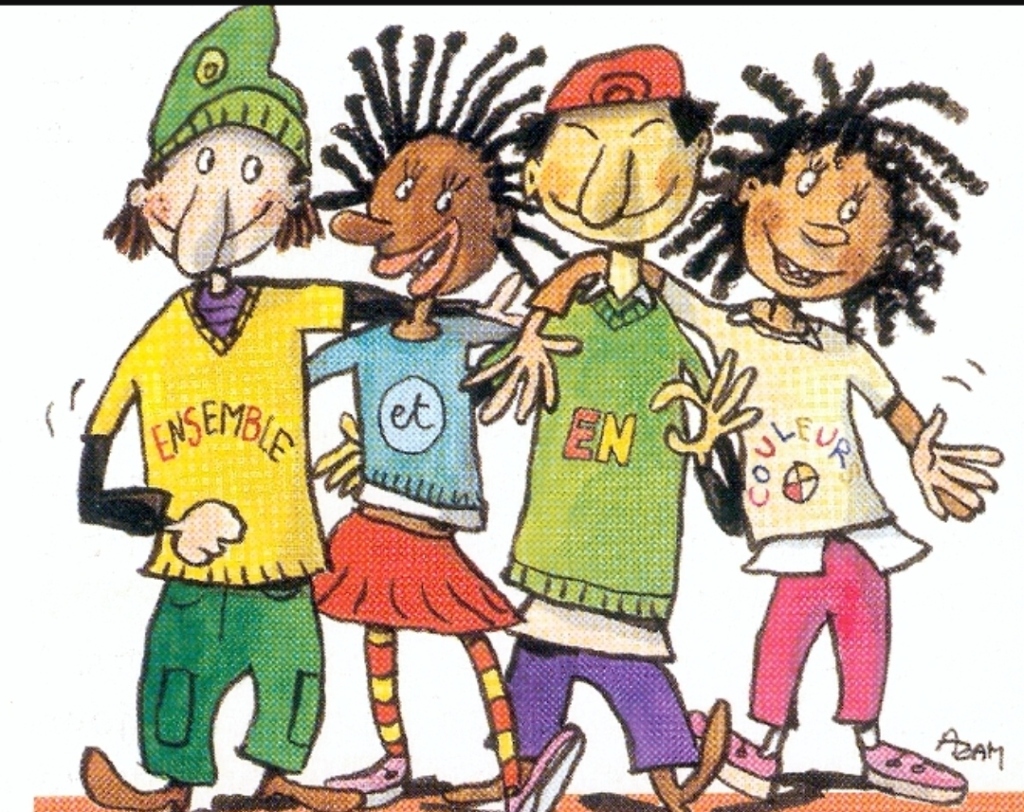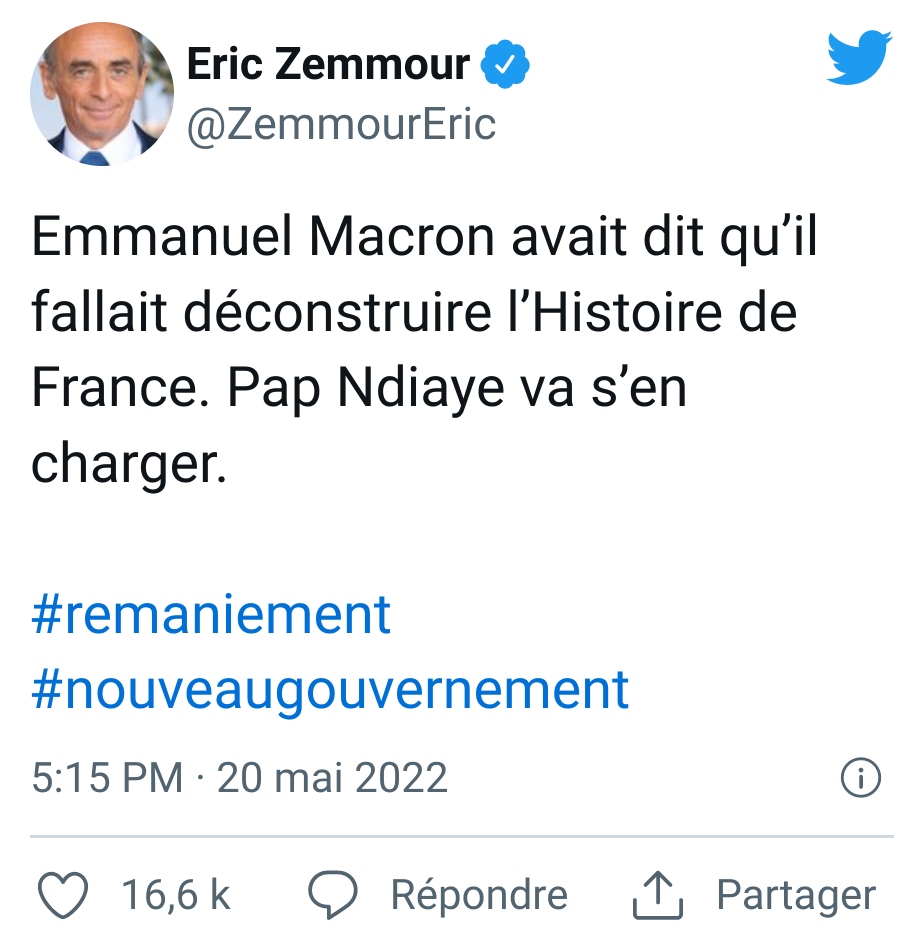Le successeur de Blanquer est l’antithèse du premier choix de Macron, président binaire dont la « pensée complexe » alarme
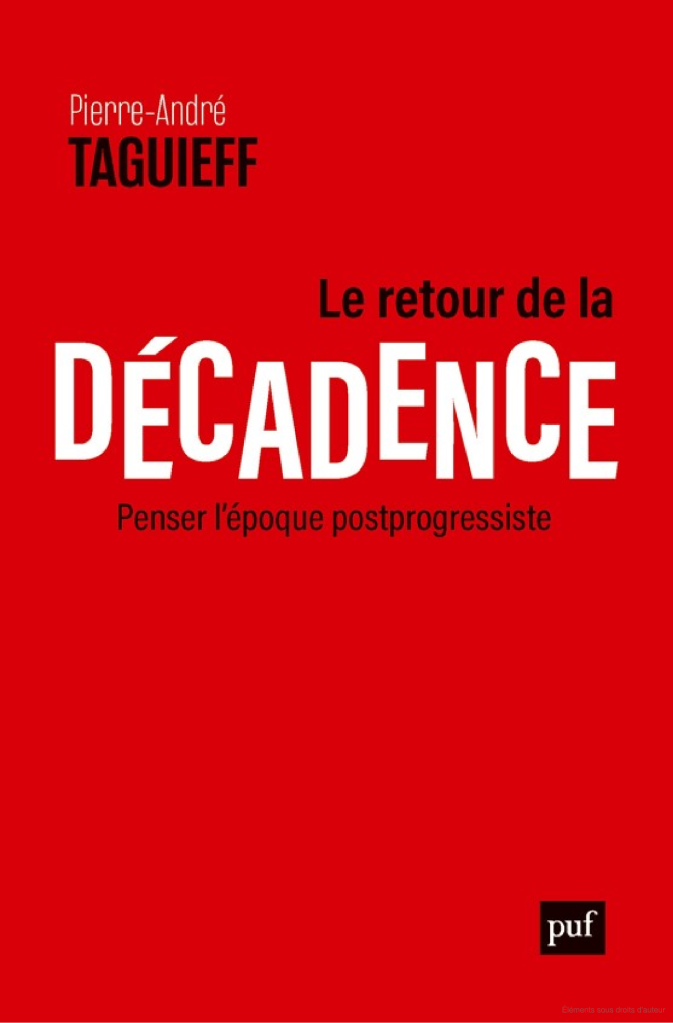
[Pierre-André Taguieff, « Pap Ndiaye a inventé le “”wokisme de salon » (propos recueillis par le rédacteur en chef adjoint des pages Débats du Figaro, Alexandre Devecchio), Le Figaro Magazine, 3-4 juin 2022, pp. 40-44.
Version complète de l’entretien, qui a dû être coupé pour être publié. L’ouvrage de Pierre-André Taguieff – philosophe, politologue et historien des idées (directeur de recherche honoraire au CNRS, auteur classé » anarcho-situationnisme » aussi bien que « néoconservateur » – cité dans l’entretien est Le Retour de la décadence. Penser l’époque postprogressiste (Paris, PUF, 2022) ], ci-contre.
La nomination de Pap Ndiaye au poste de ministre de l’Education nationale a fait couler beaucoup d’encre. Que vous inspire-t-elle ?
Pierre-André Taguieff. J’ai tout d’abord éprouvé un sentiment de stupéfaction, voire de sidération. J’aurais compris qu’un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir nomme Pap Ndiaye à ce poste. Mais comment comprendre que le président Macron puisse attendre d’un chantre de la « diversité », d’un dénonciateur des « violences policières » et d’un partisan de la discrimination positive à l’américaine qu’il poursuive les nécessaires réformes engagées par son prédécesseur Jean-Michel Blanquer ? Il s’agissait, pour ce dernier, de redonner son sens à l’école républicaine, en se réclamant sans ambiguïté des valeurs universalistes, en défendant le principe de laïcité et en réaffirmant l’autorité des professeurs. Son projet était de rétablir les conditions de l’égalité des chances et d’assurer ainsi le bon fonctionnement de la méritocratie républicaine.
[Noir comme peut l’être Obama, un métis qui rejette sa part de blanchité] Pap Ndiaye [56 ans], quant à lui, a des convictions idéologiques bien différentes qu’il a rendues publiques par ses livres (comme La Condition noire. Essai sur une minorité française, publié en 2008) et ses interviews. Elles témoignent notamment d’un intérêt particulier pour les minorités qu’il suppose discriminées (les « minorités visibles »), d’une vision raciale de la société française (composée de « Noirs », de Blancs », etc.) et de prises de position favorables à des mobilisations s’inspirant de l’antiracisme décolonial, comme celles du comité « La Vérité pour Abama », dénonçant le « racisme d’Etat » et les « violences policières » censées le traduire dans la rue. On trouve certes chez cet intellectuel engagé certaines nuances. Il dénonce, dans la société française, un « racisme structurel » et non pas, comme Rokhaya Diallo ou Assa Traoré, un « racisme d’Etat ». A propos des militants « woke », il confie à M le magazine du Monde en juin 2021 : « Je partage la plupart de leurs causes, comme le féminisme, la lutte pour la protection de l’environnement ou l’antiracisme, mais je n’approuve pas les discours moralisateurs ou sectaires de certains d’entre eux. Je me sens plus cool que “woke”. » Notre nouveau ministre a inventé le décolonialisme de bonne compagnie, ainsi que le « wokisme » de salon, « convenable » et pour tout dire institutionnel.
Dans La Condition noire, Pap Ndiaye ne cache pas la « dimension franco-américaine » de ses réflexions, manière élégante et allusive de reconnaître sa dette envers les studies fortement idéologisées qui fleurissent dans les universités anglo-saxonnes : African American Studies, Black Studies, Postcolonial Studies, etc. Il a rejoint la cohorte des universitaires militants qui, depuis les années 1990, ont trouvé dans l’antiracisme identitaire à l’américaine un substitut au marxisme : les « races » discriminées ont remplacé les prolétaires exploités. En se proposant d’ouvrir un « champ d’étude qui pourrait devenir celui des Black Studies à la française », Pap Ndiaye s’est risqué à transposer en France des modèles d’analyse empruntés à la boite à outils étatsunienne impliquant des engagements politiques « radicaux » dont il s’est efforcé d’arrondir les angles. Comme l’a dit de lui dans Le Monde (4 juin 2021) l’entrepreneur en postcolonialisme Pascal Blanchard, « Pap est un super diplomate ».
Il est soupçonné par toute une partie de la droite, mais aussi de la gauche républicaine, de vouloir faire entrer la pensée décoloniale à l’école. Comment définiriez-vous cette pensée ?
PAT. Prise au sens large, la « pensée décoloniale » repose sur onze piliers : 1° tout est « construction sociale » ; 2° tout doit être « déconstruit » ; 3° tout doit être « décolonisé », étant entendu que la « décolonisation » doit s’appliquer à toutes les institutions des « sociétés blanches » et à tous les domaines de la culture occidentale ; 4° toutes les « sociétés blanches » sont racistes et tous les « Blancs » bénéficient du « privilège blanc » ; 5° le racisme, qui est « systémique », est l’héritage de la traite atlantique, du colonialisme, du capitalisme et de l’impérialisme du monde dit occidental ou « blanc » ; 6° « l’hégémonie blanche » va de pair avec l’« hétéro-patriarcat » ; 7° « l’intersectionnalité » conceptualise la situation de personnes qui, appartenant à des « minorités », sont censées subir simultanément plusieurs formes de discrimination (de race, de genre, de classe) en toute « société blanche » ; 8° tout nationalisme, y compris le patriotisme républicain à la française, est porteur de racisme, donc de « discriminations systémiques » ; 9° le sionisme est une forme de racisme [déni d’antisémitisme] et Israël est un « Etat d’apartheid » qu’il faut démanteler ; 10° l’« antiracisme politique » consiste avant tout à lutter contre l’islamophobie et la négrophobie ; 11° ce que les islamophobes appellent « l’islamisme » n’existe pas plus que « l’islamo-gauchisme » : il n’y a que des musulmans qui souffrent de « discriminations systémiques » et sont victimes, dans les pays occidentaux, d’une islamophobie d’Etat [mise en question de la laïcité].
Pap Ndiaye s’inscrit-il réellement dans ce courant idéologique ?
PAT. On trouve dans ses publications comme dans ses prises de position publiques de nombreux emprunts à cette configuration idéologique à bords flous, mais on doit reconnaître qu’il ne coche pas toutes les cases. Pour comprendre son itinéraire, il faut rappeler que, grâce à la bourse [un « privilège blanc »] qui lui a été octroyée en 1991 [par la « société blanche », l’Etat français gangréné par un « racisme structurel » pour étudier un an à l’université de Virginie] au nom de la politique américaine de discrimination positive, il a pu poursuivre ses études à l’université de Virginie [ancien état esclavagiste] où il a préparé sa thèse d’histoire : « Je suis donc un produit de l’école républicaine française et de l’affirmative action américaine », a-t-il déclaré au Monde en 2009. Mais c’est à cette occasion qu’il a découvert le racisme et l’importance accordée aux identités raciales par les intellectuels antiracistes étatsuniens, comme il l’a reconnu en juin 2021 : « Mon passage aux États-Unis m’a permis de penser la question raciale. Ce fut une forme de révélation. » Il n’y a certes rien de honteux à se découvrir « Noir » sur le tard.

mouvement d’assertion militante de la fierté afro-américaine dans les années 60
Son engagement politique le plus clair à cet égard a été le rôle qu’il a joué dans la création du Cercle d’action pour la promotion de la diversité en France (Capvid), puis dans la fondation du CRAN (Conseil représentatif des associations noires de France), fin novembre 2006. On le trouve au bureau du Conseil scientifique (créé en mars 2007) de cette étrange organisation, qui justifie son existence en référence à une appartenance raciale marquée par une couleur de peau. Il reste que le CRAN s’est lancé dans la cancel culture, en exigeant notamment des déboulonnages de statues mémorielles. Autre indice de proximité de Pap Ndiaye vis-à-vis de l’antiracisme racialiste de la nouvelle extrême gauche : ses prises de position en faveur des statistiques ethniques. Dans La Condition noire, il « rend compte du déplacement de la lutte antiraciste vers la politique antidiscriminatoire » et « plaide pour l’utilisation de techniques statistiques afin d’établir la discrimination comme un fait social ».
Mais il est vrai que Pap Ndiaye n’a jamais été en pointe dans les milieux intersectionnalistes et décoloniaux, car il se souciait avant tout de sa carrière universitaire, ce qui l’obligeait à se montrer stratège et prudent. Pour reprendre les propos louangeurs tenus sur lui par sa sœur Marie Ndiaye, romancière devenue célèbre dans une société française supposée pourtant soumise à un impitoyable « racisme structurel », il s’est efforcé de se fabriquer une image attrayante de « conciliateur » et de « pacificateur », convenant à ses ambitions institutionnelles – accéder avant tout à des postes de direction, ce qu’il a parfaitement réussi à faire, à Sciences Po Paris (directeur du département d’histoire), au Musée national de l’histoire de l’immigration (directeur général du Palais de la Porte-Dorée, 1er mars 2021) et au Centre national du cinéma et de l’image (président de la « commission images de la diversité », janvier 2022), avant d’être nommé le 20 mai 2022 ministre de l’Education nationale [par le cynique Macron]. Tout en donnant des gages aux militants décoloniaux, il tenait à se démarquer des figures médiatiques les plus caricaturales du décolonialisme, telles que l’indigéniste et islamo-gauchiste Houria Bouteldja ou Rokhaya Diallo, qui se définissait en janvier 2017 comme « féministe intersectionnelle et décoloniale ».
Il est venu cependant au secours de l’exaltée Assa Traoré aux propos accusateurs et incendiaires, en déclarant avec complaisance et peut-être empathie en juillet 2020 : « Au fond, quand on la lit, quand on l’écoute, son discours est rassembleur. J’entends un discours de convergence plutôt qu’un discours de clivage et de séparation, un discours qui réclame l’égalité. » Il légitimait ainsi le pseudo-antiracisme fondé sur la dénonciation litanique des « violences policières », autre importation des radicaux étatsuniens. Car la militante décoloniale Assa Traoré désignait clairement l’« ennemi commun : le système », le « système » criminel qui, selon elle, « tue » les jeunes issus de l’immigration. Elle précisait ainsi, en 2018, sa vision intrinsèquement négative de la société française : « En France, la ségrégation sociale est doublée d’une ségrégation raciale : ce qui se passe aujourd’hui dans les quartiers s’inscrit dans la suite de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. » [Ca valait bien un maroquin !] On reconnaît la thèse du « racisme systémique ». Comment, lorsqu’on prétend être, une fois nommé ministre, un « pur produit de la méritocratie républicaine », peut-on assumer d’avoir attribué à l’agitatrice Traoré, entourée de dénonciateurs de l’universalisme républicain en tant que masque du racisme, un « discours rassembleur » ? [une illustration de la « pensée complexe » macronarde »]
Impressionné par la meute des gauchistes islamismophiles qui pétitionnaient avec indignation contre l’emploi de l’expression « islamo-gauchisme », Pap Ndiaye a prudemment pris ses distances le 19 février 2021, sur France Inter, vis-à-vis des positions prises sur le sujet par Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal – laquelle avait le 14 février 2021 demandé de mener une enquête sur l’islamo-gauchisme à l’université –, en déclarant avec sa seule autorité d’un spécialiste des minorités « de couleur » aux Etats-Unis :
« Ce terme [d’islamo-gauchisme] ne désigne aucune réalité, bien entendu, dans l’université. C’est plutôt une manière de stigmatiser des courants de recherche (…) [des travaux sur] l’intersectionnalité, [c’est-à-dire] une manière de croiser des approches antiracistes, antisexistes, par exemple, de considérer que les situations sociales sont le fruit d’entrecroisements, qui sont le fruit de discriminations diverses, si vous voulez. Ça, ce sont des recherches tout à fait importantes, qui irriguent la recherche internationale. Et donc il serait évidemment catastrophique de les mettre à l’index. »
Et de préciser, non sans une certaine morgue : « Ce qui me frappe, c’est plutôt le degré de méconnaissance, dans le monde politique en général, des recherches qui sont menées à l’université en sciences sociales et en sciences humaines. (…) Ils n’ont qu’une idée extrêmement vague de ce qu’on appelle la recherche universitaire. » Quant à Pap Ndiaye, « intellectuel internationalement reconnu » (selon ses laudateurs), auteur d’une œuvre considérable (sa thèse et quatre livres, dont deux petits ouvrages scolaires et un recueil d’articles), il sait ce qu’est la recherche « en sciences sociales et en sciences humaines » : études de genre, « théorie critique de la race », intersectionnalité, postcolonialisme et décolonialisme.
Ne faut-il pas attendre avant de le juger ?
PAT. Il faut en effet éviter tout procès d’intention sur la base de ce que nous connaissons de ses orientations idéologico-politiques. D’abord parce que, comme tout acteur politique, il peut en changer ou les corriger selon les contextes. Et l’homme a montré qu’il était particulièrement souple. Ensuite, en raison de l’importance de l’administration de l’éducation, puissante organisation impersonnelle qui absorbe les chocs idéologiques au nom de la « continuité du service », devant gérer en permanence un million de personnels et douze millions d’élèves. Enfin, parce que le citoyen engagé dans l’antiracisme à l’américaine, impliquant une centration sur la race marquée par la couleur de peau et le prétendu « racisme structurel », devra compter, en tant que ministre, avec la tradition républicaine à la française qui, conformément à ses valeurs et à ses normes universalistes, prône l’indifférence à la couleur et ne réduit pas les identités individuelles à des échantillons d’identités ethno-raciales. L’essentialisme racial et l’identitarisme ethnique à base victimaire sont des produits idéologiques importés principalement des campus étatsuniens aux mains d’organisations néo-gauchistes radicales. Mais, compte tenu de son « ouverture » à ces courants idéologiques, on peut craindre que Pap Ndiaye [comme ministre] ne compose avec les syndicats, les groupes de pression et les mouvements politiques ralliés au wokisme et à la cancel culture. Ce qui serait une catastrophe pour le système d’enseignement français.
Votre nouveau livre s’intitule Le Retour de la décadence. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
PAT. Une approche philosophique du déclin et de la décadence ne peut se passer d’analyses préliminaires relevant d’une sémantique historique. Le mot « déclin » enveloppe les représentations d’un processus naturel comme « vieillissement », « sénescence » et « fin de » (ou « mort naturelle »), métaphorisé notamment par le mot « crépuscule ». C’est en ce sens que Spengler emploie le terme dans Le Déclin de l’Occident (1918 et 1922). Le mot « décadence », quant à lui, implique les représentations de processus pathologiques polymorphes (à fortes connotations théologiques ou morales), tels que la « dégénérescence », la « déchéance », la « décrépitude », la « dégradation », la « maladie », l’« écroulement », l’« effondrement », l’« acheminement vers la ruine » ou la « désintégration ». Il faut y ajouter la métaphore du « naufrage ». Les visions naturalistes et « rassuristes » du déclin se distinguent des visions catastrophistes ou apocalyptiques de la décadence. Cependant, dans bien des cas, il est impossible de trancher entre la thèse d’une mort naturelle et celle d’une mort violente. Si l’on peut retarder un déclin, on peut éviter un naufrage, voire remonter la pente d’une décadence.
Le terme « décliniste » a longtemps visé une partie de la droite. Vous montrez qu’il existe un déclinisme de gauche, voire d’extrême gauche à travers l’ « écologisme » ?
PAT. Je souligne en effet que les prophètes de déclin ou décadence, voire de fin du monde ou de chaos final, surgissent aujourd’hui surtout dans les milieux écologistes. C’est sur ces thèmes apocalyptiques qu’ils mobilisent. Le malheur de la pensée écologique tient à ce qu’elle est trop souvent instrumentalisée et exploitée par des illuminés sectaires et des démagogues cyniques, qui prétendent monopoliser les « bonnes » positions, c’est-à-dire celles qui relèvent des modes idéologiques mondialisées se nourrissant de grandes peurs collectives. C’est pourquoi leur rhétorique est manichéenne. Même un supposé « modéré » comme Yannick Jadot s’exprime comme un extrémiste fanatique : « On a un choix entre deux options : l’écologie et la barbarie » (16 mars 2022).
L’écologisme est devenu une gnose, c’est-à-dire un savoir qui sauve, mais qui n’est plus réservé à un petit nombre. A l’âge démocratique, les gnoses perdent leur caractère ésotérique pour faire l’objet d’un endoctrinement de masse. L’écologisme fonctionne comme une religion de salut à laquelle se sont converties toutes les mouvances de gauche et d’extrême gauche, y compris les décoloniales, qui y voient une manière particulièrement efficace et consensuelle de diaboliser la civilisation occidentale, source à leurs yeux de tous les maux. Les militants écologistes rejoignent donc logiquement le camp bariolé des ennemis de l’Occident, un Occident maudit et prédateur qu’ils réduisent au productivisme, au capitalisme ou au néolibéralisme.
Pour autant, ne faut-il pas prendre au sérieux l’enjeu écologique ?
PAT. Bien entendu, mais après l’avoir arraché des mains douteuses des faux prophètes, des marchands d’apocalypse et des histrions idéologiques qui se multiplient dans le champ des « nouvelles radicalités ». Mais je reste lucide : la « dégauchisation » de l’écologie durera longtemps. On n’effacera pas facilement un processus d’appropriation culturelle et politique qui a si bien marché.
Votre critique du progressisme ne vous conduit donc pas à donner dans le déclinisme ?
PAT. Je suis trop sceptique pour être un adepte du déclinisme, qui n’est après tout que le produit d’une inversion simple de l’optimisme progressiste le plus sommaire. Passer de la prédiction béate « ce sera mieux demain » à la lamentation nostalgique du type « c’était mieux avant », c’est tourner en rond. La grande illusion est aujourd’hui de croire qu’on ne peut en finir avec le catéchisme progressiste qu’en adoptant le catéchisme décliniste.
Il faut poser le problème au niveau du destin des civilisations. Ma thèse est que lorsqu’une civilisation perd confiance en elle-même, elle est vouée à consentir à son effondrement. La question de la perte de confiance en soi, face à une crise comme face à une menace, est déterminante. Dans son bel essai sur « les religions meurtrières » paru en 2006, l’historien israélien Elie Barnavi, faisant référence à la menace islamiste, n’hésitait pas à lancer avec lucidité : « Une civilisation qui perd confiance en elle-même jusqu’à perdre le goût de se défendre, entame sa décadence. » Or, l’individualisme hédoniste et consumériste, qui est l’idéologie dominante de la civilisation occidentale moderne, paralyse la volonté et neutralise le courage, ouvrant la voie à la soumission. La fierté civilisationnelle est en baisse dans les pays occidentaux, en même temps que s’accroît la culpabilité de « l’homme blanc », ce malheureux bénéficiaire principal du prétendu « privilège blanc » saisi par une haine de soi doublée d’une honte de soi, devenu la cible principale de l’activisme décolonial et « wokiste ».
L’idée d’une re-barbarisation de telle ou telle civilisation est à prendre au sérieux. Elle nous rappelle qu’une civilisation est une longue construction sociohistorique qui reste fragile, même et peut-être surtout lorsqu’elle parvient au faîte de sa puissance. Les civilisés trop satisfaits sont des proies faciles. En outre, étant déçus, voire désespérés à la moindre averse, ils peuvent se métamorphoser en ennemis internes de leur culture ou de leur civilisation, comme nous le montrent aujourd’hui le mouvement décolonial et le néo-antiracisme « wokiste », dont la cible commune est la civilisation occidentale tout entière.
Diriez-vous que la percée de l’idéologie décoloniale à l’université, dans le monde de la culture et peut-être demain à l’éducation nationale est un symptôme de décadence ?
PAT. Si l’on entend par décadence une rupture de transmission d’un ensemble de valeurs et un processus de décomposition d’une civilisation ou d’une culture nationale, alors l’imprégnation décoloniale croissante qu’on observe peut être interprétée comme un indice de décadence. Ce qui est sûr, c’est que, pour ceux qui croient d’abord qu’il existe une culture française et qu’il faut la transmettre et la faire fructifier plutôt que la déconstruire, ensuite que l’héritage des Lumières, toujours certes à repenser, doit être défendu et illustré, ce à quoi nous assistons apparaît comme une régression qui, plus profondément, pourrait être une décivilisation. Husserl notait que « le monde la culture, sous toutes ses formes, existe par la tradition ». Et il n’y a pas de tradition sans héritage ni transmission. Les interruptions violentes de transmission produisent des déculturations parfois irrémédiables. L’avenir répulsif que nous entrevoyons, c’est l’invention d’un nouveau tribalisme, un tribalisme postnational, fondé notamment sur la racialisation de divers groupes identitaires en conflit permanent. [En février 2017 à Lyon, Macron a lancé : « Il n’y a pas de culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse »].
Le paradoxe est que ce néo-tribalisme coexiste et interfère avec les produits de la corruption idéologique de l’universalisme occidental d’origine chrétienne, représenté par la célébration des droits de l’homme [de l’Humain, désormais ! ] (de partout et nulle part) au détriment des droits et des devoirs du citoyen (toujours de quelque part). Ces croyances et ces valeurs néo-chrétiennes concentrées dans un cosmopolitisme moral devenu un catéchisme ne font plus rêver qu’une poignée de prédicateurs sans autre auditoire universel que l’écho de leurs prières et de leurs prêches en faveur du relativisme ou du pluralisme, de l’ouverture, de la tolérance et de la « bienveillance », du « care », de la « diversité » et de l’« inclusivité ». En ce qu’elle était censée annoncer l’unification, l’uniformisation et l’égalisation des pensées et des styles de vie, l’occidentalisation juridico-politico-morale du monde a échoué. On connaît le mot apocryphe attribué à Aristote : « La tolérance et l’apathie sont les dernières vertus d’une société mourante. » Mais l’agonie peut durer longtemps, sur le mode d’une euthanasie lente.
Peut-on, dès lors, échapper au déclinisme et au pessimisme ?
PAT. Le sentiment qu’on vit l’époque de la fin des grands espoirs collectifs n’a cessé de nourrir les visions modernes et postmodernes de la décadence. Et ce, qu’on la pense classiquement comme fin de l’âge des héros ou, à la manière moderne, comme fin des promesses de libération ou d’émancipation, engluées dans le culte de la consommation qui accompagne l’émergence des sociétés d’abondance. Peut-être le sentiment d’assister à une décadence finale et de vivre les « derniers jours de l’humanité » relève-t-il d’une esthétisation du déclin, qui se traduit régulièrement par la contemplation d’une « apocalypse joyeuse », produit d’une transfiguration festive du taedium vitae, ce dégoût de la vie qui peut donner paradoxalement des raisons de vivre. Cioran a noté sobrement : « Dans l’histoire, seules les périodes de déclin sont captivantes. » Et Nietzsche [mort en 1900] , persuadé que « l’Europe est un monde qui s’effondre », célébrait en 1884 la contemplation esthétique de l’agonie européenne : « Un monde qui s’effondre est un plaisir non seulement pour le spectateur, mais aussi pour le destructeur. »
On ne peut vraiment échapper au pessimisme radical qu’en s’installant inconfortablement dans le tragique. Il est envisageable de le faire sans s’abandonner aux passions tristes. Le héros tragique est gai, suggérait Nietzsche. Giono, pour sa part, indiquait la voie avec simplicité : « Je crois que ce qui importe, c’est d’être un joyeux pessimiste. » On peut cependant hésiter entre le pessimisme joyeux (la gaieté sans illusions) et « l’optimisme tragique » évoqué par Emmanuel Mounier.
La situation n’est peut-être pas sans espoir. On peut s’en tenir à ce « peut-être ». La peur du déclin, voire de la fin, pourrait être un moteur du progrès, mais d’un progrès qui n’aurait plus rien à voir avec l’idole abstraite dont le culte a constitué le cœur de la religion des Modernes. Un progrès qui reste à imaginer, par-delà toute forme de nécessitarisme. Je l’ai baptisé « méliorisme » dans les années 1990. C’est le meilleur usage imaginable de la peur et du sentiment de déclin ou de décadence. Car, après tout, l’espèce humaine est inventive, elle a montré dans l’histoire qu’elle pouvait trouver des solutions aux problèmes les plus épineux. L’inconséquence serait de sortir de la vision nécessitariste du Progrès sans fin pour sombrer dans une vision fataliste du déclin final. Dans les deux cas, on se laisse porter par la vague, celle qui conduit au meilleur ou celle qui mène au pire. Deux visions également paresseuses, et qui alimentent la paresse, l’une comme l’autre nous assurant que nous n’avons rien à faire qu’à attendre. La passivité n’est pas une vertu. Elle inspire l’attentisme et l’opportunisme.