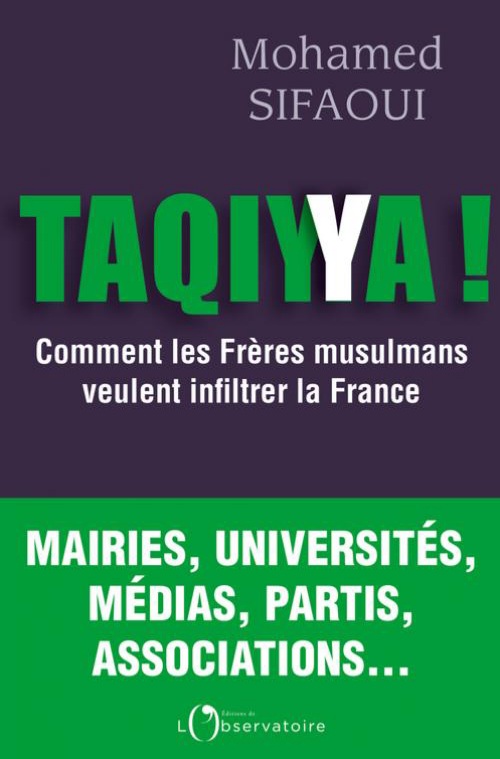A l’attention des décoloniaux et des geignards vindicatifs

Pour les personnes d’origines non européennes qui se prétendent victimes de racisme ou descendants des victimes de l’esclavage, voici la petite Histoire dans la grande Histoire qui permettra je l’espère de remettre le clocher au centre du village…
Dans sa chronique, l’historien Samuel Touron évoque un pan de l’Histoire peu évoqué dans nos universités : la traite des esclaves blancs en Barbarie qui concerna entre 1,3 millions et 2,5 millions de personnes, hommes et femmes, dont une partie du Sud de la France, l’actuelle Provence et le Languedoc.
Victor Hugo dans Ruy Blas créait le diabolique et manipulateur Don Salluste, odieux personnage qui, afin de retrouver les bonnes grâces de la monarchie espagnole, n’hésite pas à faire livrer aux Barbaresques son neveu Don César. Cette pièce, qui entra dans la culture populaire avec le film de Gérard Oury, La Folie des grandeurs, où le génial Louis de Funès incarne l’affreux Don Salluste rendant la réplique à un fringant Ruy Blas joué par Yves Montand, montrait pour la première fois au cinéma un épisode très peu étudié par les historiens et largement méconnu en France : la traite des esclaves blancs en Barbarie.

Jan Goeree (1670-1731) & Casper Luyken (1672-1708)
La traite des esclaves de Barbarie est le commerce d’êtres humains, majoritairement des Blancs européens, qui a fleuri principalement entre les XIVe et XVIIIe siècles dans les marchés d’esclaves du littoral de la côte des Barbaresques, correspondant approximativement à l’aire côtière du Maghreb actuel, de la Mauritanie et du Maroc jusqu’à l’Egypte exclue, entre bande sahélienne et Méditerranée. Les Maghrébins actuels de France d’Afrique du Nord qui se plaignent de la colonisation française apprendront qu’ils ont été dominés tout au long de leur Histoire et peuvent en vouloir aujourd’hui aussi bien aux Phéniciens, aux Grecs et aux Romains qu’aux Byzantins, leurs frères musulmans qui les ont soumis à tour de rôle. Ainsi les marges Est du Maroc furent plus ou moins occupées par les Turcs de la régence d’Alger. Les Français mirent un terme à la soumission des territoires du Maghreb et les développèrent.
Ainsi, en janvier 1956, la France découvrit du pétrole pour la première fois au Sahara, à Edjeleh, dans la région d’In Amenas (Fort Polignac à l’époque). La découverte du plus grand champ pétrolier algérien, Hassi Messaoud, est intervenue en juin de la même année. Une réussite de la Société nationale de recherches de pétrole en Algérie (SN REPAL), créée en 1946 par le Bureau de recherche de pétrole (BRP, devenu Elf Aquitaine en 1976) avec le siège installé à Hydra au-dessus de la ville d’Alger. Lien vers Roger Goetze. L’Algérie n’eut plus qu’à la nationaliser en Sonatrach et à s’attribuer le mérite de son classement en première entreprise d’Afrique et pilier de l’économie algérienne. Lien
Les Ottomans colonisent l’Afrique du Nord
Qu’est-ce que la Barbarie ? La Barbarie désigne jusqu’au XIXe siècle la côte nord-africaine s’étendant du Maroc à la Tripolitaine c’est-à-dire l’actuelle Libye. Ces terres ne connaissent pas de pouvoir central fort ni de système politique organisé autour d’une structure étatique. A partir du XIVe siècle, les Ottomans [les Turcs actuels] prennent le contrôle de l’Afrique du Nord et s’imposent en maîtres sur la région. Ils n’y exercent néanmoins qu’un pouvoir lointain laissant à des chefs locaux l’essentiel des fonctions régaliennes. L’affrontement entre mondes chrétien et musulman, caractérisés par l’ensemble des croisades menées entre le XIe et le XIIIe siècle se poursuit largement à compter du XIVe siècle au travers de l’expansion de l’Empire Ottoman, étant donné que la Reconquista a stoppé puis réduit l’expansion arabo-musulmane sur l’Espagne, le Portugal et la moitié Sud de la France. A partir de ce moment charnière, deux événements conjoints vont expliquer l’âge d’or de la traite des esclaves blancs au Maghreb.
De 400 000 et 800 000 personnes quittent l’Espagne
D’abord en 1492, la chute de Boabdil, émir de Grenade, entraîne le début du reflux massif des Morisques vivant en Espagne vers l’Afrique du Nord, notamment en raison du décret de 1502 qui fait de l’ensemble des sujets espagnols, des catholiques. En 1609, le roi Philippe III d’Espagne prend un décret promulguant l’expulsion des Morisques. Ils furent entre 400 000 et 800 000 à quitter la péninsule ibérique, la plupart vivant en Aragon (20 % de la population totale) et dans la région de Valence (40 % de la population totale). Une fois au Maghreb, ils furent massacrés par les populations locales qui voyaient en eux des chrétiens et, qui plus est, des renégats. Ceux qui survécurent vinrent gonfler les rangs des pirates barbaresques, notamment de la République de Salé où des morisques originaires du village d’Hornachos en Estrémadure ont fondé une république corsaire.

Dar-el-Islam, Dar-al-Ahd, Dar-al-Harb
En parallèle, à compter du XIVe siècle, les Ottomans mettent la main sur l’Afrique du Nord. Ils annexent également, à la même période, les terres allant jusqu’au Yémen, au sud-est, et dominent les Balkans depuis la chute de Constantinople en 1453. L’Empire Ottoman est alors à son apogée.
En Islam, le monde se divise en trois catégories: le Dar-al-Islam, “territoire de l’Islam” ; le Dar-al-Ahd, “territoire de l’alliance”, rassemblant les Etats ayant fait alliance avec les pays musulmans et le Dar-al-Harb désignant le “territoire de la guerre”, où il faut combattre les infidèles, principalement les chrétiens. L’objectif de chaque souverain étant d’unifier l’ensemble de ces territoires sous le Dar-al-Islam. Cette conception de l’organisation du monde, combinée à l’expansion d’une grande puissance musulmane, ainsi qu’à l’analyse de la situation que nous avons faites en Afrique du Nord et dans la péninsule ibérique, permet de comprendre les raisons qui expliquent le développement de la traite des esclaves blancs en Barbarie.
Ainsi, musulmans et chrétiens s’affrontent tant sur terre que sur mer. Sur terre, la situation est contrastée, nous l’avons vu, les Ottomans sont, certes, aux portes de Vienne, mais les Morisques viennent d’être chassés de la péninsule ibérique. Sur mer, la bataille de Lépante est remportée par la coalition chrétienne face aux troupes ottomanes en 1571. Cependant, les musulmans ne peuvent se résoudre à laisser la domination des mers aux chrétiens. La traite des esclaves s’impose alors comme une solution de choix pour les Ottomans.
Le Languedoc et la Provence sont notamment victimes de ces raids incessants depuis le début de l’an 1000.
En effet, les Barbaresques pratiquent la traite des esclaves depuis l’Antiquité, la région de Béjaïa en Kabylie est alors connu comme étant le grand repère des Barbaresques. En effet, Béjaïa est proche d’Alger où se trouve le plus important marché aux esclaves du monde musulman. Le Languedoc et la Provence sont notamment victimes de ces raids incessants depuis le début de l’an 1000. Les villes côtières languedociennes et provençales se sont construites en hauteur afin de dominer la mer et de pouvoir faire face aux incursions, au pillage et au vol des hommes, des femmes et des enfants. Les Maures s’installent notamment dans le massif du même nom (dans le Var, entre Hyères et Fréjus) et sont à l’origine du nom de plusieurs localités dont Ramatuelle (Rahmatu-Allah) signifiant miséricorde divine ou encore Saint-Pierre d’Almanarre (Al-Manar signifant le phare). Jusqu’au XVIIIe siècle, les Languedociens et les Provençaux vivent avec la menace des incursions barbaresques, de même que l’ensemble des résidents du pourtour du nord de la Méditerranée occidentale. Les Ottomans exploitèrent par la suite cette longue tradition en donnant davantage de moyens aux Barbaresques, notamment en les équipant en navires.
Des raids jusqu’à Reykjavik, en Islande
Redoutables corsaires, les Barbaresques dominèrent les mers entre le XVIe et le XVIIIe siècle : ils pillaient et attaquaient tous les navires chrétiens qu’ils croisaient en Méditerranée et en Atlantique et menèrent des raids jusqu’à Reykjavik, en Islande. Durant cette période, la violence des Barbaresques était telle que les terres comprises entre Venise et Malaga connurent un exode généralisé vers leurs arrières-pays. Certains villages disparurent car l’ensemble de la population fut déportée et réduite en esclavage. Le 20 juin 1631, le village irlandais de Baltimore est, par exemple, entièrement vidé de ses habitants. En Islande, entre 400 et 900 personnes sont prises, puis vendues à Alger en 1627. Une question se pose alors : que deviennent ces esclaves ?
Esclaves vendus sur les marchés d’Alger, Tripoli, Tunis…
La plupart d’entre-eux sont vendus sur les marchés d’Alger, de Tripoli ou de Tunis, au côté notamment des esclaves noirs, notamment en Libye. Les hommes d’un statut social peu élevé sont vendus à des propriétaires où ils travaillent comme serviteurs ou dans des exploitations agricoles et fermières, d’autres sont vendus comme galériens et rament leur vie durant dans les galères barbaresques ou ottomanes. Les femmes sont vendues comme domestiques ou pour alimenter les harems qui étaient entièrement composés de femmes européennes ou subsahariennes.
En effet, il est interdit en islam d’asservir à des pratiques sexuelles ou divertissantes une femme musulmane. Le rôle des plus séduisantes d’entre-elles est de fournir des successeurs au sultan. Les esclaves les plus riches ou les plus influents étaient, eux, conservés pour rançon. Parmi les esclaves célèbres des Barbaresques notons l’auteur espagnol Miguel de Cervantès vendu comme esclave à Alger en 1575 à la suite de la bataille de Lépante et racheté par En 1580, il est racheté par les Trinitaires en même temps que d’autres prisonniers espagnols et regagne son pays. Enfin, les jeunes garçons étaient convertis à l’islam et éduqués pour devenir des janissaires, c’est-à-dire des combattants dans un corps spécial au service de l’Empire Ottoman. Les jeunes filles, elles, rejoignaient le harem.
Les Américains donnaient 20 % de leur budget pour que leurs navires ne soient pas rançonnés
Peu d’historiens se sont intéressés à la traite des esclaves blancs en Barbarie, notamment à son poids démographique et économique, il est pourtant considérable. Sur une période allant de 1 500 à 1 800, on estime le nombre de personnes réduites en esclavage entre 1,3 et 2,5 millions. Le poids économique est délicat à calculer mais, à titre d’exemple, le gouvernement américain allouait 20 % de son budget aux Barbaresques afin que leurs navires marchands ne soient pas rançonnés.
Au début du XIXe siècle, les puissances européennes s’unirent pour mettre un terme à l’esclavage des Blancs en Afrique du Nord. Dès le Congrès de Vienne de 1815, les bases sont posées “pour l’abolition de l’esclavage des blancs aussi bien que des noirs en Afrique”, selon les mots de l’Amiral Sidney Smith de la Royal Navy. En 1830, la conquête d’Alger par la France mit un terme définitif à la traite des esclaves en Afrique du nord et au règne des Barbaresques.
d’après Samuel TOURON
Lire : La traite arabo-musulmane (lien PaSiDupes)