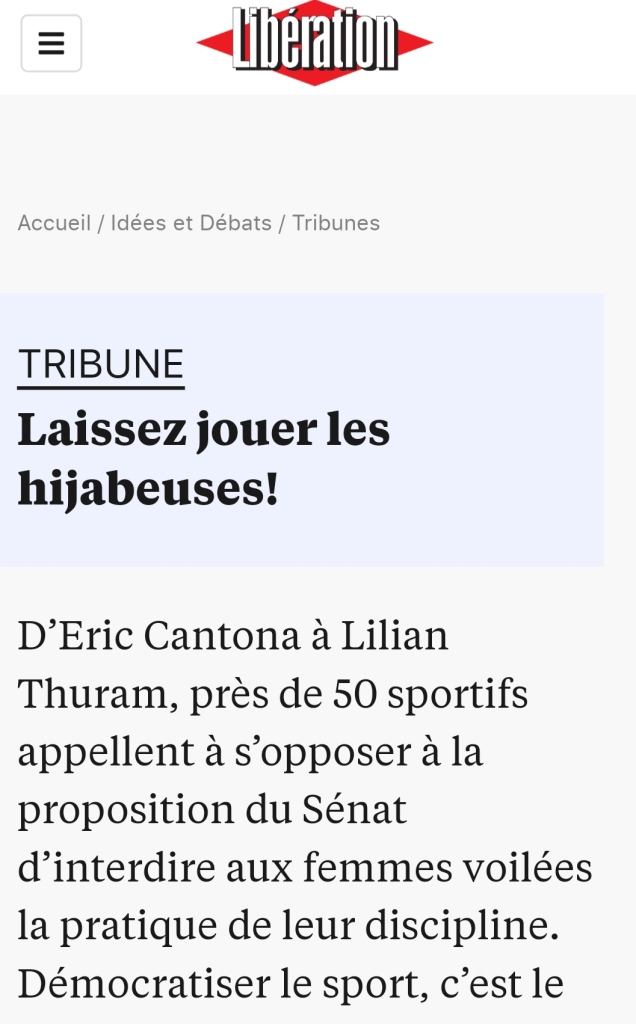Le voile islamique serait tolérable au national, mais choquant à l’international

le pouvoir politique est humilié
Ce qui est insupportable pour l’image de la France à l’international serait adapté à ses régions, selon un juge administratif formaté à la culture du compromis. Quelle place accorde-t-il réellement au droit ? Quelle part aux lobbies associatifs et à l’air du temps ? Avec en tête le « sens de l’Histoire », le Conseil d’Etat a examiné un recours des « hijabeuses » contre l’article 1 du règlement de la FFF, qui leur interdit de jouer voilées lors des compétitions
Le gouvernement tire sur le camp de la laïcité

Le juge administratif a eu à trancher la question du hijab sur les terrains de football. Il a examiné lundi un recours des « hijabeuses » contre la Fédération française de football (FFF) qui leur interdit de jouer voilées lors des compétitions. Il aura à le faire pour le handball ou le basketball et tous les sports les uns après les autres, car le harcèlement est la stratégie des séparatistes. A l’Assemblée, la Nupes dépose des tombereaux d’amendements; dans la société civile, on submerge les tribunaux.
Le collectif conteste donc devant la justice l’article 1 du règlement de la FFF qui interdit depuis 2016 « tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ».
Une décision attendue d’ici trois semaines
Lors de l’audience, le rapporteur public, Clément Malverti, qui dit le droit et dont l’avis est généralement suivi, a recommandé l’annulation de cet article 1. La décision sera rendue d’ici trois semaines.
Si Clément Malverti a estimé que la question pouvait se poser pour les joueuses sélectionnées en équipe de France, où elles représentent « la Nation » et effectuent « une mission de service public », elle est « autrement plus discutable » pour les autres joueuses licenciées de la FFF. Il a commencé par rappeler la « distinction fondamentale » entre agents du service public, auxquels le principe de « neutralité » s’applique, et les usagers, « libres » de manifester leurs convictions tant qu’ils ne troublent pas l’ordre public.
Des joueuses portant le voile de facto « exclues »

Il n’y a ni « prosélytisme », ni « provocation » dans le seul port du hijab, et aucune « exigence de neutralité » pour les joueuses licenciées de la FFF, a déclaré Clément Malverti. Avec le règlement actuel de la FFF, qui a le « monopole » sur l’organisation des matchs, les joueuses portant le voile sont de facto « exclues » et doivent « renoncer à toute compétition et toute carrière ».
L’avocat de la FFF a, lui, soutenu qu’il fallait au contraire « consacrer l’exigence de neutralité pour l’ensemble des joueurs ». « Ce qui est recherché, c’est l’importation dans le football de revendications communautaires », a poursuivi Me Loïc Poupot, estimant que les compétitions s’étaient toujours disputées en « des termes neutres », avec des sportifs que seule la couleur du maillot distinguait, et que le règlement de 2016 n’avait fait que graver dans le marbre cette réalité.
Les « hijabeuses » attendent avant de « crier victoire »

Il n’y a aucune « exigence de neutralité » pour les joueurs de football, et le football est « truffé » de signes d’appartenance religieuse, a martelé le rapporteur public, citant la « croix de Malte » sur les maillots des joueurs d’Auxerre. Sauf que le juge ne connaît pas son dossier : ce sont les héritiers de l’AJA et de son histoire de club, un ancien patronnage créé par l’Abbé Deschamps (mort en 1949) qui a laissé son nom au terrain de l’équipe. Il cite encore les joueurs qui font un signe de croix furtif en entrant sur le terrain. Sauf que le juge se croit au Maroc ou en Algérie où les joueurs chrétiens ne s’expriment pas, à la différence de Benzema ou Anelka, Nasri et Ribéry qui ont scandalisé avec des prières sur le terrain et des insultes à l’hymne national.
Ce juge pouvait en effet évoquer l’irrespect de Benzema, langue sortie, et Nasri, hilare se dissimulant, qui bafouaient La Marseillaise en début de match international:

Il a aussi noté que la FIFA et « l’ensemble des fédérations sportives internationales » autorisent le port du hijab en compétition. Parmi ces pays mis en exergue, combien se revendiquent-ils laïcs ?
Se refusant de « crier victoire » trop vite, l’avocate du collectif, Me Marion Ogier, co-fondatrice, avec Lionel Crusoé, du cabinet Andotte Avocats (Andotte est le nom de citoyenne de Madame Jeanne Odo, connue sous le nom de « Citoyenne Andotte », ancienne esclave native de Saint-Domingue), s’est réjouie en marge de l’audience des conclusions du rapporteur public. En même temps, le cabinet assure que, « comme Andotte, nous pratiquons le droit pour faire bouger les lignes. » Elle a espéré que le Conseil d’Etat, en prenant sa décision, ne fasse « du droit, rien que du droit » sans se laisser influencer par la « politique » devant une dizaine de hijabeuses amenées pour assister à l’audience. En même temps, son cabinet assure que, « comme Andotte, nous pratiquons le droit pour faire bouger les lignes« …
La loi coranique prévaut-elle sur la loi républicaine et les règlements sportifs?

sauf selon les séparatistes islamistes
Avec la Tour Eiffel (marqueur de l’espace) en toile de fond, elles posent en hijab réglementaire – aucune mèche de cheveux ne dépasse – sur l’une des affiches promouvant ci-dessus la participation citoyenne à la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Mais elles combattent le réglement de la FFF.. « L’avenir est entre vos mains ». Cette manifestation est organisée et coprésidée par les trois institutions de l’Union européenne, la Commission, le Parlement et le Conseil. Elles ne sont pas laïques, mais la France laisse imposer aux Français des préférences qui ne sont pas les leurs… En revanche, la loi coranique – revisitée – prévaut sur la loi républicaine, toute laïque qu’elle soit censée être.
Le Conseil d’Etat fait-il le jeu des islamistes ?
La nomination du conseiller d’Etat Thierry Tuot à la présidence de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat surprend le milieu. Constitue-t-elle un risque raisonnable?
Les magistrats progressistes ont les plus belles perspectives de carrière, comme les doctorants bien-pensants à l’université. A l’inverse, un lycéen récalcitrant à l’écriture inclusive s’expose à la malveillance vertueuse des correcteurs au baccalauréat. A fortiori, les étudiants rebelles ne peuvent former d’ambitieux espoirs.
Voyez Thierry Tuot, conseiller d’Etat, président-adjoint de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat, est nommé président de cette même section en conseil des ministres mercredi 22 février 2023. A compter du 6 mars, il succédera à Sylvie Hubac, ancienne directrice de cabinet de François Hollande à l’Elysée. Or, les analyses de ce Tuot, 61 ans, dérangent depuis déjà bien longtemps.
« Parfois, j’ai la trouille de la racaille dans certains quartiers, mais je ne supporte pas qu’on dise que c’est de la racaille parce qu’elle est maghrébine. C’est tout ».Thierry Tuot, Libération du 26 mars 2013.
En 2000, Thierry Tuot, conseiller d’Etat et ancien directeur du Fonds d’action sociale (FAS), publiait – sous le pseudonyme de Jean Faber – un ouvrage critique sur les politiques françaises d’intégration intitulé Les indésirables : l’intégration à la française. Par ce titre fort, l’auteur entendait parler de « tous ceux qui sont perçus et désignés comme “immigrés”. J’essaye de me mettre dans leur peau, et je pense qu’ils ont le sentiment d’être indésirables. On n’a pas souhaité qu’ils viennent en France, on ne souhaite pas vraiment qu’ils restent, et s’ils le font, on veut qu’ils soient le moins visibles et le moins “immigrés” possible ». Cette approche est biaisée, car le problème n’est pas là, mais se situe dans les manifestations – culturelles et religieuses – communautaristes qui participent du séparatisme politique.
Treize ans plus tard, Thierry Tuot récidive, mais cette fois sous son vrai nom et à la demande du premier ministre Jean-Marc Ayrault adressée à Thierry Tuot, en août 2012, lui confiant la rédaction d’un rapport sur « l’état de la politique d’intégration » et la proposition de « nouveaux concepts et axes d’action pour en assurer un nouveau départ »., dans un rapport intitulé La grande nation : pour une société inclusive . Son rapport et le qualificatif d’“indésirable” décrivant l’immigration, avait reçu un accueil franchement hostile, à droite comme à gauche, y compris chez ses commanditaires, au point d’avoir suscité une forme de “consensus du silence” consistant à ne plus en parler.
Le rapport a estampillé Thierry Tuot « islamophile » et « immigrationniste ». En somme, pour nombre de commentateurs, le rapport Tuot cherche à justifier les échecs des politiques de la gauche en matière d’immigration/intégration, en renversant les données du problème (le refus de certains immigrés de s’intégrer à la société française) : «Ce qui ressort du rapport, c’est que le concept même d’intégration est vidé de son sens. On finit par réduire l’intégration à une simple insertion dans la société. Et lorsqu’on évoque l’intégration, on renverse alors les rôles, à savoir qu’il revient au peuple d’accueil de s’intégrer aux derniers arrivés, cela en accommodant le contenu des principes et valeurs qui sont pourtant au cœur de son identité ».
A gauche, l’embarras a prévalu face à un document dont l’auteur est sûrement estimé pour sa rigueur et ses compétences professionnelles, mais dont les analyses sont parfois perçues comme “trop angéliques” à l’égard de l’immigration. Le gouvernement a donc fait comme si le rapport Tuot n’avait jamais existé.
Quand les media ont choisi de rendre compte du rapport, ils se sont généralement contentés de publier les mesures les plus polémiques (notamment celles relatives aux sans-papiers et aux musulmans), occultant l’esprit du texte car, au-delà de la controverse publique, le rapport Tuot véhicule une philosophie du vivre ensemble que l’on pourrait qualifier d’humanisme pragmatique ou de volontarisme public au service de la cohésion nationale. L’auteur rappelle souvent sa posture éthique : sa mission est de servir l’Etat (au sens large) et son rapport entend répondre précisément à cet objectif désintéressé. Pour ce faire, il expose d’abord sa philosophie du vivre ensemble (l’inclusion), avant de procéder à une critique sévère des politiques d’immigration/intégration menées en France depuis plus de 20 ans, pour livrer enfin une série de propositions originales, relevant à la fois du registre symbolique et des politiques publiques.
Le rapport Tuot prône-t-il un “multiculturalisme à la française” ? En fait, il considère le multiculturalisme comme une impasse politique et sociétale, qui est celle de « la voie des cultures d’origine, du multiculturalisme et de la reconnaissance institutionnalisée de la diversité. L’Etat, les pouvoirs publics, n’ont, pourtant, aucune légitimité pour reconnaître ou définir les “bonnes” cultures ». En même temps, ce rejet du multiculturalisme ne le conduit pas pour autant à verser dans une forme d’assimilationnisme rénové, style IIIe République. L’auteur cherche à prendre ses distances autant à l’égard des partisans du multiculturalisme que des nostalgiques du village gaulois, adeptes de la représentation d’une France éternelle et intemporelle qui n’existe que dans certains livres d’histoire : « Qu’on pense, du reste, si l’on veut à tout prix ramener la France et sa grandeur, à la puissance d’un pays fort de la diversité des sources de son peuplement, uni dans une société fraternelle face à la mondialisation ! Qui sera le meilleur commercial, du pays replié sur sa ronchonne célébration du village d’autrefois, ou de celui fier de ses visages contemporains magnifiant une culture vivante et dynamique ? Quels marchés s’ouvriront au premier, confit dans la célébration, partielle et partiale, d’un passé mythifié, et au second, affichant ses cultes, ses croyances, ses succès, ses enfants libres ? Lequel gagnera la course à l’innovation, qui demande mobilité des angles de vue, regards iconoclastes, travail de groupe aux talents divers et mise en réseau au travers des frontières ? Lequel pourra apparaître aux yeux des autres pays comme une référence morale, culturelle, spirituelle, apte à tenir un discours d’exemplarité ? ».
En ce sens partisan sur la base caricaturale, la notion d’intégration doit être critiquée, dans la mesure où elle relève davantage de la mythologie politique [village gaulois] que de la politique publique, en maintenant les individus et les groupes “à intégrer” dans un statut particulariste [favorisé par des associations qui trouvent intérêt à constituer des campements mobilisables et des ghettos susceptibles d’entretenir des tensions de déstabilisation] qu’elle se propose pourtant de dépasser : « Les défauts de l’intégration sont d’instrumentaliser ses destinataires en en faisant des sujets passifs, de supposer un parcours temporel qui se prête mal aux réalités des trajectoires personnelles hétérogènes, d’exiger de définir les publics qu’on sait observer mais pas subsumer sous une variable autre que celle dont on veut gommer les effets, qui stigmatise au moment où l’on veut que cesse le stigmate ». L’auteur juge stérilisante l’hégémonie de la doxa de l’intégration “à la française”, qui, sous couvert de cohésion nationale, ne cesserait de fabriquer du différentialisme : « Mot magique, l’intégration s’est imposée aux cours des années 1980-1990 comme une référence incontournable du discours politique, de l’action publique, des mobilisations associatives et, au-delà, de l’expertise sociale et de la recherche scientifique, annihilant toute distance critique à l’égard d’une ‘notion’ pourtant fortement connotée sur le plan historique. La rhétorique intégrationniste a fonctionné ainsi comme une prophétie autocréatrice, trouvant sa justification dans sa propre énonciation ».
Renonçant à l’ambition de l’assimilation, la volonté de Thierry Tuot de dépasser le cadre étroit de l’intégration au profit d’une perspective inclusive – ce qui paraît être un projet minimaliste, voire une expression creuse – ne verse jamais dans l’utopie d’une France multiculturelle. Bien au contraire, animé par une forme de patriotisme humaniste, le juge, fier de son progressisme, appelle à reprendre collectivement « l’écriture du roman national », non en regardant vers le passé, mais en étant en phase avec son temps : la société inclusive « c’est assurer peu à peu la capacité collective de reprendre l’écriture du roman national plutôt que d’en fêter avec nostalgie et amertume les images d’Epinal jaunies et flétries ».
On comprend dès lors que le conseiller d’Etat se montre extrêmement critique de l’effacement de la puissance publique dans de nombreux secteurs de la société française aujourd’hui sinistrés, que cet homme de gauche compare à une « politique de casse » systématique, une essentialisation, totalement contradictoire avec l’objectif d’intégration.
En premier lieu, une politique de casse de l’intelligence qui a consisté à démanteler la plupart des institutions académiques et d’expertise œuvrant dans le domaine de l’immigration, sans doute parce que celle-ci n’a jamais été considérée comme un “objet noble” de la recherche française. Le résultat d’un tel processus est de livrer l’objet “immigration” à l’empire des préjugés, des clichés et du sens commun faisant ainsi le jeu des populismes en tout genre : « On a cassé l’effort de recherche, en coupant les crédits et arrêtant les programmes. L’observation s’est arrêtée, l’analyse, l’évaluation, la comparaison, donc la réflexion, la théorisation, la prospective et la conceptualisation. Une politique intelligente repose sur l’intelligence de la situation : elle nous échappe, désormais, et il faut le plus souvent à nos meilleurs chercheurs aller voir ailleurs. La disparition d’une ambition scientifique réduit en conséquence le débat public à des propos de comptoir – ravageurs, réducteurs et trompeurs ».
Mais, plus grave encore, les politiques adoptées par les différents gouvernements de droite comme de gauche ont abouti à casser les initiatives émanant de la “société civile”, en réduisant les associations à une peau de chagrin : « On a au passage ainsi maltraité les acteurs – la mortalité associative a été grande. La généralisation des appels d’offres a éliminé toute appréciation qualitative fine des associations et fait disparaître les plus modestes. La disette financière a déstructuré les réseaux associatifs avant de les détruire. Combien ont sombré ? Sans doute la moitié. On voudrait être sûr que le contrôle accru que permettent les appels d’offres a éliminé les plus mauvais, et que les survivants sont tous les meilleurs – mais on peut en douter. La dilution de la présence publique dans le secteur, l’absence d’étude et de suivi rendent impossible de dépasser les impressions en la matière ».
L’auteur n’est pourtant pas tendre avec certaines organisations de solidarité en faveur des travailleurs immigrés qu’il qualifie de “faux résistants”, cherchant à rejouer en 2013 le maquis du Vercors, alors que le contexte socio-historique a profondément changé. Néanmoins, cette politique de casse associative est bien une réalité qu’il entend dénoncer : elle s’est exercée en dépit du bon sens, alourdissant au final la facture publique au profit de structures privées et/ou médiatiques animées par des objectifs principalement mercantiles. Les financements sur projets au détriment de celui des structures a favorisé le ponctuel, le provisoire et l’absence d’ancrage réel dans les territoires au profit des capteurs professionnels de subventions publiques.
Cette politique de casse associative s’est généralement accompagnée d’un jeu de chaises musicales concernant les institutions spécialisées dans le domaine “immigration/intégration”, celles-ci étant fusionnées, reconverties, restructurées ou carrément supprimées au gré des humeurs gouvernementales du moment : « Hormis le tour de bonneteau convertissant le fas et la div en daic et acsé, et les appauvrissant au passage, les structures institutionnelles sont restées en jachère […]. Qu’on n’en conclue pas que tout est devenu noir – rien n’a jamais été rose. C’est précisément ce qui est préoccupant : un appareil administratif imparfait, incohérent, peu efficace, mal contrôlé, a été privé de ressources, déconstruit et désarticulé ».
Ce rapport au vitriol a également été écrit à l’encre noire, ne se contentant pas de critiquer, de déconstruire, de fustiger ou de distribuer des bons points et des avertissements aux acteurs publics, mais cherchant aussi à jeter les bases d’une politique d’inclusion, combinant à la fois des réformes institutionnelles et des mesures symboliques fortes. L’auteur s’attelle à l’esquisse de la définition d’une politique publique visant à promouvoir une société inclusive.
Malheureusement, les media et les contradicteurs publics du rapport Tuot ont redouté sa proposition de création d’un « titre de tolérance » pour les sans-papiers qu’ils assimilent abusivement à une volonté de l’auteur de régulariser massivement les “clandestins”. Or, il n’en a jamais été question dans le rapport, puisqu’il s’agit d’instaurer un « trajet » de cinq ans, où le candidat au titre de séjour devra franchir une série de « bornes », au terme desquelles les autorités françaises pourront décider ou non de le régulariser : « Tout manquement à l’une des bornes, qui ne pourrait être justifié au moins par la démonstration des efforts faits, entraînera immédiatement le retrait du titre de tolérance, le placement en rétention, qui pourrait alors par la loi être porté à une durée plus importante, des moyens plus intenses pouvant être concentrés pour la reconduite à la frontière dans un pays qui peut d’ailleurs être un autre que celui d’origine ». Une mesure “laxiste” convenant à la gauche, mais dénoncée par la droite et les responsables de l’UMP. L’angélisme du conseiller d’Etat alimente la crainte d’un « humanisme pragmatique » dont les bases sont floues.
D’abord, une volonté très nette de rompre avec les approches particularistes de l’intégration qui consistent à lutter contre le mal par le mal (avec des références implicites à l’ethnicité), preuve d’un certain sadomasochisme républicain : on prétend lutter pour l’intégration en promouvant des politiques ciblant des publics spécifiques (les immigrés, les enfants d’immigrés, les banlieusards basanés, etc.). Or, pour Thierry Tuot, une politique d’intégration est d’abord une politique sociale : « La politique à conduire est une politique sociale […]. Elle vise à apporter à chacun, selon son besoin, équitablement, les outils, les appuis, qui corrigeront les dysfonctionnements sociaux ; elle vise à accompagner la transformation sociale permanente que notamment, les flux migratoires (comme la mondialisation, la technologie, le progrès médical, l’évolution des mœurs, etc.) génèrent en permanence. La société bouge et nul ne peut arrêter le temps (même si, comme le répètent les conservateurs depuis quarante siècles qu’ils écrivent, c’était mieux avant) : le devoir de l’Etat est de faciliter les choses et de garantir l’équité. Celle-ci résultera nécessairement d’une politique sociale. Sociale ne veut pas dire pour autant prestations, ou assistance : mais effort collectif, travail patient, règles nouvelles visant à compenser, réparer, faciliter ; aide et solidarité, accompagnement par des travailleurs sociaux spécialisés, mutualisation, interaction des acteurs sociaux ».
Or, la meilleure façon de surmonter ce dilemme de l’ethnicité est de fonder cette politique sociale non sur des critères liés à l’origine ethnique, culturelle ou religieuse des habitants, mais sur des critères territoriaux. La politique d’inclusion doit viser non pas des populations particulières, mais des territoires, sélectionnés en fonction d’indicateurs sociaux généraux : « Il est difficile de viser les publics, car les désigner les stigmatise, les identifier objective le fantasme de la différence et le cristallise. Il faut désormais viser les territoires où la dimension d’extranéité des populations est la source des difficultés sociales. La politique à conduire sera donc territoriale – ce qui entraîne des avantages et des conséquences. Le premier avantage est de rendre la politique possible, sortant du dilemme “nommer pour stigmatiser/ne pas désigner pour ne pas traiter”. Le second est de la rendre cohérente avec les politiques analogues, de la ville, du logement, de l’éducation, et de renforcer les effets. Le troisième est d’en assurer complètement l’équité – en visant un territoire on visera tous ses habitants et non une fraction désignée par sa peau ou sa religion ».
Toutefois, cette politique sociale ambitieuse ne sera possible que si les pouvoirs publics renoncent définitivement à la “casse de l’intelligence” pratiquée depuis plusieurs années. Ainsi, Thierry Tuot appelle à refonder le Haut Conseil à l’intégration (hci), qui pourrait devenir le Haut Conseil à la nation (HCN) et renouerait avec sa vocation initiale : produire une expertise lucide et rigoureuse sur l’état des flux migratoires, les politiques d’inclusion, les inégalités sociales et territoriales, et cela en étroite coordination avec les grandes institutions académiques et scientifiques de la nation (CNRS, INED, Université, etc.).
Plutôt que des institutions d’apparat qui servent surtout à recaser les politiques en perte de vitesse ou les sportifs à la retraite — ce qu’est devenu le HCI depuis une dizaine d’années — il s’agirait de promouvoir des synergies institutionnelles, dotées d’une réelle capacité de diagnostic, d’analyse, de proposition et de prospective, qui puissent se déployer dans un climat sain, libérées des jeux de coteries et des allégeances politiques du moment : « Au-delà de l’urgence de disposer de statistiques claires, expliquées, et justifiées, pour lesquelles on a proposé la garantie d’un HCI refondé, nous avons besoin d’une recherche universitaire puissante, variée, indépendante, internationalisée. Nous devons disposer de laboratoires nombreux, exposant et interprétant l’histoire de notre société dans sa dimension liée aux immigrés. Nous devons comprendre le fonctionnement de la société depuis l’échelle des psychologies individuelles jusqu’aux sociologies d’ampleur nationale. Nous devons apprécier l’évolution des mouvements de population, et tenter de discerner ce que seront les flux migratoires à venir. Nous devons connaître les religions, les croyances et les mœurs. Nous devons pénétrer les mentalités, les manières d’être, les valeurs et les motifs. Un immense programme s’ouvre à nous, d’études, de recherche, de réflexion, de synthèse interdisciplinaire ».
A ce stade du rapport, on pourrait légitimement croire que son auteur, un haut fonctionnaire, verse dans une forme d’élitisme, laissant aux seuls savants le soin de définir les grandes lignes de la politique d’intégration. Au contraire, et à rebours des discours institutionnels fétichisant le “réalisme budgétaire”, Thierry Tuot plaide pour une véritable politique associative qui redonne une place aux organisations de la société civile comme acteurs à part entière des politiques d’inclusion. Constatant le « désert associatif » provoqué par une politique de coupes budgétaires, l’auteur en appelle à adopter « un plan de sauvetage », au profit de structures pérennes (et pas seulement des projets) qui sont les seules à connaître les populations et les territoires : « Il faut retrouver les voies et moyens d’un sauvetage puis d’une pérennisation du tissu associatif, car pendant les débats, les travaux continuent, et tenir les débats sans agir aboutira à un choix par défaut – faute d’associations survivantes, on pourra décider qu’elles n’ont plus aucun rôle à jouer » .
Au-delà des politiques publiques stricto sensu, l’auteur croit aussi en la force des symboles, visant à réhabiliter la mémoire des lieux et des hommes: « On propose ici au débat des gestes symboliques, qui souvent n’ont pas de portée pratique considérable ou ne coûtent rien au budget de l’État, mais dont la force peut être le témoignage d’un changement radical de climat, quittant l’atmosphère de crainte, de suspicion, de mépris, réels ou supposés, qui dégradent profondément le climat public et rendent illusoire tout appel à la raison. Il est vain d’appeler chacun à ses droits et devoirs, si la République ne commence pas par assumer pleinement les siens ». Parmi ces mesures symboliques proposées par l’auteur : les carrés musulmans dans les cimetières, la création de lieux de mémoire dans les cités, la célébration des anciens, etc. Il ne s’agit pas de faire de la “politique symbolique” par compassion républicaine, misérabilisme tiers-mondiste ou charité chrétienne, mais bien d’inscrire le destin des populations issues de l’immigration dans une filiation historique longue avec la nation française, celle des anciens combattants, des constructeurs de nos routes et de nos villes, des travailleurs, c’est-à-dire de tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont versé leur sang et leur sueur pour bâtir la France.
Le rapport Tuot n’est donc en rien l’œuvre d’un haut fonctionnaire égaré, devenu poète orientaliste ou militant pro-immigrés. Loin de verser dans une quelconque forme d’angélisme, sa lecture approfondie révèle au contraire une posture réaliste, une philosophie du “vivre ensemble national” guidée par une éthique : servir l’Etat au nom du bien commun.
Dans une période où les ambitions personnelles, les intérêts privés, les appétits financiers et les tentations du repli particulariste gagnent du terrain, le rapport Tuot ne pouvait que déranger, parce qu’il vient réveiller nos vieux démons et secouer nos mauvaises consciences.
On le voit, cet énarque est néanmoins toujours dans la course.
Souvent homme politique à convictions fortes varie:
Tous les musulmans n’approuvent pas ces provocations séparatistes :