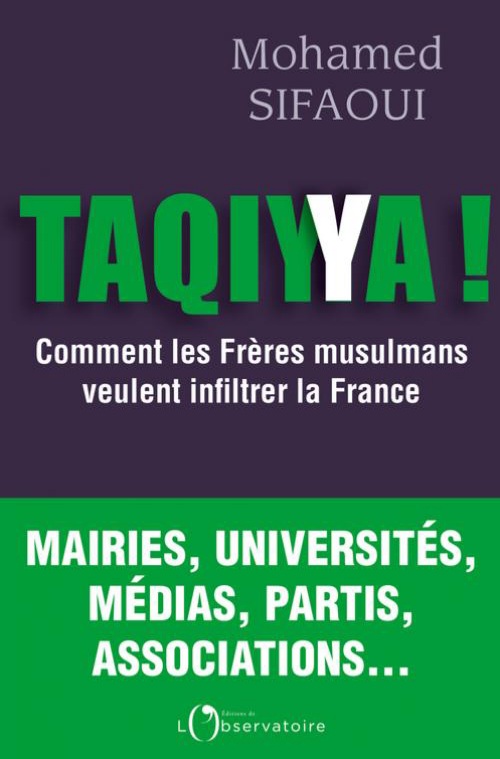Entre hypocrisies, mensonges et incompétence

La commission d’enquête de l’Assemblee nationale visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France a auditionné de nombreuses personnalités politiques dont Ségolène Royal, Lionel Jospin ou bien encore Manuel Valls.
Ludovic Dupin est directeur de l’information de la Société française d’énergie nucléaire.
Valérie Faudon est Déléguée Générale de la Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN) et Vice-Présidente de l’European Nuclear Society (ENS). Elle est enseignante à Sciences-Po dans le cadre de la Public School of International Affairs. Elle a été Directrice Marketing d’AREVA de 2009 à 2012, après avoir occupé différentes fonctions de direction chez HP puis Alcatel-Lucent, aux Etats-Unis et en France. Valérie est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Elle est aussi titulaire d’un Master of Science de l’Université de Stanford en Californie.
avec Ludovic Dupin et Valérie Faudon
Atlantico : Certains passages comme celui de Ségolène Royal devant la Commission d’enquête souveraineté énergétique ont fait beaucoup parler. Que retenir de sa prise de parole ?
Valérie Faudon : Ce qui est marquant dans les déclarations, et notamment dans celles de Manuel Valls et de Ségolène Royal, est que la décision de réduire à 50 % notre part du nucléaire est bien politique. Ségolène Royal explique ainsi que ni le parti socialiste, ni EELV n’avaient les moyens de faire une instruction sérieuse en 2011, et qu’elle n’a pas été faite non plus en 2015. Elle est d’ailleurs très honnête sur le sujet. Mais on dirait qu’elle ne se rend pas compte des conséquences que cela a pu avoir sur les employés de la filière ou la sécurité d’approvisionnement énergétique.
L’autre point marquant, c’est que le débat de ces dernières années a été centré sur l’opposition nucléaire/renouvelable alors que le vrai sujet était les 60% d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) qui a été un point aveugle de la politique française. Les efforts pour sortir des énergies fossiles sont passés sous le radar, alors qu’ils sont les grands responsables des émissions de gaz à effet de serre du pays. A noter aussi que, avec la crise actuelle, nos importations d’énergie ont plus que doublé en 2022 et dépassé les 100 milliards d’euros.

Et plus largement quels sont les faits marquants des différentes déclarations devant la Commission ?
Valérie Faudon : Que ce soit avec François Hollande (qui n’a pas été auditionné) ou Manuel Valls, il semble qu’il n’y avait pas de volonté délibérée de leur part de faire du mal à la filière nucléaire, mais qu’ils n’ont pas mesuré ce qu’ils en faisaient. Cédric Lewandowski, directeur du parc thermique chef EDF, l’a bien dit dans son audition, une enquête interne de 2015 montrait que le moral des troupes chez EDF était très bas, il y avait eu des difficultés de recrutement.
Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est aussi le manque de préparation de ces annonces. Les politiques n’ont pas du tout compris que nous nous mettions en situation de difficultés d’approvisionnement. L’un des vrais angles morts des politiques est aussi celui de la consommation d’électricité. La sobriété n’est pas suffisante; pour sortir du fossile, il faudra aussi à long terme augmenter notre production d’électricité pour remplacer certains usages. Un bon exemple, dans les transports, est celui de la voiture électrique. Et nous sommes passés d’une situation de surcapacité au niveau européen à la situation inverse, sans le voir venir. La France a fermé ainsi 10 GW de capacités de production pilotable en 10 ans, incluant Fessenheim. On a vu la même tendance en Europe. Or, même si on développe les renouvelables, on a besoin de capacités pilotables, qui fonctionnent 24h/24 pour équilibrer l’offre et la demande d’électricité sur le réseau. Les auditions de Pierre Gadonneix ou d’Henri Proglio (anciens PDG d’Edf) montrent que ces derniers savaient qu’ils pourraient prolonger les réacteurs plus longtemps que prévu, mais qu’il faudrait maintenir la compétence de construction pour lancer un programme de renouvellement des réacteurs à partir de 2020. Cette idée s’est perdue en 2011-2012 avec l’abandon du projet d’EPR à Penly.
Pour Manuel Valls, la réduction de 50 % du nucléaire « n’était le résultat d’aucune étude d’impact » mais d’une optique « uniquement politique ». Comment l’expliquer ?
Valérie Faudon : La négociation sur le sujet au PS s’est faite entre les équipes de Martine Aubry et de Cécile Duflot, avant la primaire de la gauche. François Hollande est arrivé tardivement dans les négociations. La justification avancée par François Hollande à l’époque était, dans un entretien au Nouvel Observateur : « Je propose de réduire de 75% à 50% la production d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2025. Exactement le même effort que les Allemands, qui vont passer de 22% à 0% en quinze ans. » Et évidemment on voit bien que l’Allemagne n’y arrive pas. Mais à l’époque il y avait une vraie admiration pour l’Allemagne en matière de politique énergétique.

Yves Bréchet avait taclé l’inculture politique en matière énergétique et un personnel politique qui ne lisait pas les rapports d’experts avant de prendre des décisions. Est-ce que les auditions laissent transparaître ?
Valérie Faudon : CE qui est clair, c’est que la question scientifique est compliquée pour un politique, et on l’a bien vu lors de la crise Covid où des experts donnaient en public des avis divergeants. La parole scientifique doit être avant tout une parole collégiale, et il est important que des instances scientifiques soient mises en place et donnent des avis publics et documentés. C’est sans doute ce qui a manqué durant toute la période sur la question du nucléaire. Il ne s’agit pas pour le politique d’être scientifique, mais que le scientifique puisse s’exprimer et être une ressource pour le politique. Et cette expression a été mal organisée pendant au moins 10 ans. Le rapport « Futurs Energétiques 2050 », publié par RTE fin 2021, fruit de deux ans de travail et de concertation entre experts de l’énergie, a permis, en créant un cadre commun, les avancées que nous connaissons aujourd’hui.
Ne faut-il pas rechercher les responsabilités aussi lors de la période Jospin/Voynet, eux aussi interrogés ?
Valérie Faudon : Ce qui est étonnant dans le discours de Jospin à l’audition, c’est son explication sur l’arrêt de Superphénix et notamment le très court délai pour prendre cette décision, il explique avoir pu faire l’instruction en 1997 entre son élection et son discours de politique général 15 jours plus tard. Il déclare qu’il s’agissait avant tout d’une décision industrielle. Mais l’instruction de ce dossier ne peut pas avoir été faite convenablement si rapidement. Superphénix était un projet important sur lequel des fonds étaient avancés, qui comptait pour l’industrie française, pour la recherche, etc.

Pour voir la vidéo : cliquez ICI
Quel bilan tirer de ces auditions ?
Ludovic Dupin : C’est un très bel exercice qui remet en perspective les décisions de ces 20 dernières années. Les intervenants sont de bonne foi, on voit clairement que la parole scientifique n’a pas toujours été écoutée ou qu’elle n’était pas la priorité de l’agenda. C’est une source documentaire incroyable.
Valérie Faudon : Chaque acteur rappelle bien quelle était la situation et sa position au moment où il était aux manettes, c’est un effort de contextualisation qui est important et nécessaire. Mais le cœur de la problématique, c’est la parole des experts, comment elle est orchestrée et prise en compte par le politique.